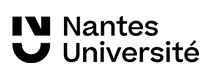À la recherche de la fonte à la cire perdue
Projet de recherche - Origine et développement technique dans la métallurgie de l’âge du Bronze italien
Projet de recherche de 6 mois (septembre 2024 - mars 2025) de Marilou Nordez, chercheuse du LARA, résidente auprès de l’École française de Rome 
Lieu : École française de Rome
Enjeux du programme : Participer à réviser le scénario diffusionniste d'adoption de la technique de la fonte à la cire perdue. Cette innovation permet au métallurgiste de couler des objets complexes dans leur forme et leur décor. En Italie, elle est considérée comme datant du Xe s. av. n. è., tandis qu'elle est parfaitement maîtrisée dès le XVe s. av. n. è. sur les rives de l'océan Atlantique : s’agit-il d’un réel écart chronologique dans le développement de la technique ? Est-ce plutôt un biais de source, cette technique ne laissant que très peu de vestiges archéologiques et les objets obtenus par ce procédé n’étant pas nécessairement enfouis (et donc systématiquement recyclés) ? Ou est-ce un biais de la recherche, les indices d’emploi de cette technique n’ayant pas encore été suffisamment exploités ? Ce projet ambitionne de pondérer ces différentes hypothèse, en vue de proposer un scénario de développement de cette technique basé sur des données archéologiques.
Nature de l’opération : projet de recherche prospectif
Direction : Marilou Nordez (CNRS, UMR 6566 CReAAH - LARA)
Soutien : projet non financé
Le projet
Une technique a permis aux métallurgistes de s’affranchir des contraintes techniques des moules en une ou plusieurs pièces, autorisant la production de formes et de décors complexes : la fonte à la cire perdue.

Cette technique était jusqu’à récemment admise comme une innovation de fin de l’âge du Bronze en Europe occidentale et centrale, qui se serait développée à partir de contacts avec la Méditerranée orientale au début du Ier millénaire avant notre ère.
Un scénario différent doit désormais être envisagé, son emploi étant bien antérieur sur la façade atlantique, notamment pour la fabrication de bracelets en bronze massif décorés dès le XVe siècle avant notre ère.
En Italie, la technique de la fonte à la cire perdue est généralement considérée comme une innovation du Xe siècle avant notre ère, faute de vestiges antérieurs. Ce décalage de cinq siècles entre Europe atlantique et péninsule italique soulève plusieurs questions : s’agit-il d’un réel écart chronologique dans le développement de la technique ? Est-ce plutôt un biais de source, cette technique ne laissant que très peu de vestiges archéologiques et les objets obtenus par ce procédé n’étant pas nécessairement enfouis (et donc systématiquement recyclés) ? Ou est-ce un biais de la recherche, les indices d’emploi de cette technique n’ayant pas encore été suffisamment exploités ?
Ce projet a pour objectif de pondérer ces différentes hypothèses à travers l’étude d’objets archéologiques italiens potentiellement obtenus par fonte à la cire perdue.
Ces résultats contribueront à affiner et réviser le scénario du développement de cette technique depuis le Ve millénaire à l’échelle des continents eurasiatique et africain.