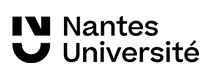Gennes, l’agglomération antique et son devenir au haut Moyen Âge
Projet collectif de recherche – Gennes (Maine-et-Loire)


À droite : Fouilles du "nymphée" de Gennes (Maine-et-Loire). Crédits : X. Favreau, 2023
Date de début : janvier 2022
Enjeux : étudier l’agglomération de Gennes depuis le début de la période romaine jusqu’à la fin du haut Moyen Âge (Ier s. av. J.-C. - Xe s.), à travers la fouille de plusieurs monuments : "nymphée" et aqueduc d'époque romaine, nécropole à sarcophages alto-médiévale, églises ; questionner la relation de Gennes à son environnement sur le temps long.
Nature de l'opération : projet collectif de recherche (PCR) 2022-2025 : fouilles, étude de bâti, prospections pédestre et géophysique
Co-direction : Laure Déodat (CNRS, UMR 6566 CReAAH - LARA), Xavier Favreau (CDP49), Mickaël Montaudon (CDP49), Martin Pithon (Inrap, UMR 6566 CReAAH - LARA), Arnaud Remy (CDP49), Pauline Thonniet (Eveha), Alexandre Polinski (Archaeodunum, UMR 6566 CReAAH - LARA), David Aoustin (Université Rennes, UMR 6566 CReAAH)
Soutien : CNRS, AuGuRA, Nantes Université, CReAAH-LARA, DRAC – SRA des Pays de la Loire, conservation départementale du patrimoine de Maine-et-Loire (CDP49), Inrap, Municipalité de Gennes
> équipe 6 du CReAAH
----
Le projet
L’objectif de ce projet, engagé en 2022, est de questionner l’agglomération de Gennes, depuis le début de la période romaine jusqu’à la fin du haut Moyen Âge (Ier s. av. J.-C. - Xe s.), à travers différents angles d’approche. C’est donc Gennes dans son ensemble - qu’elle soit agglomération, vicus, village, bourg -, qui est au centre de cette recherche collective.
Depuis la mise en place du PCR, la recherche est organisée selon deux axes chronologiques, faisant l’objet de plusieurs opérations.
Le premier axe, intitulé « l’agglomération antique : origine et développement de Gennes à travers la parure monumentale - le nymphée, l’aqueduc, l’édifice de spectacle -, les traces d’occupation et la circulation », est porté par L. Déodat, X. Favreau et M. Pithon. À ce stade de l’enquête, seuls les deux premiers monuments (le nymphée et l’aqueduc) sont à l’étude.
Le second axe, intitulé « l’occupation alto-médiévale : l’évolution du bourg de Gennes à travers les cimetières, les églises, le réseau viaire et autres traces d’occupation », est porté par L. Déodat, M. Montaudon, D. Morleghem et A. Remy. Deux églises (Saint-Eusèbe et Saint-Vétérin) et une nécropole / cimetière à sarcophages, font l’objet d’études.
Par ailleurs, les différents travaux menés sur les monuments et leur insertion dans l’agglomération sont alimentés, d’une part, par une enquête archivistique et, d’autre part, par les apports de la géoarchéologie.
Ce dernier point est traité à travers deux thématiques transversales, permettant de tisser un lien entre les sites et les périodes étudiés, deux enquêtes essentielles à la compréhension générale de l’objet d’étude. La première, portée par A. Polinski, concerne les matériaux de construction et leurs sources d’approvisionnement ; la seconde, portée par P. Thonniet, s’occupe des interactions sociétés-milieux.
L’année 2025 sera destinée à présenter une synthèse globale du PCR à travers les résultats des fouilles et des diverses analyses engagées et les différentes enquêtes, archivistiques et géoarchéologiques. Un film documentaire sera également produit à l’issue de cette année.
---
> Premiers résultats : Gennes est identifiée comme une agglomération secondaire antique existant au moins dès les premières décennies du Ier s. de notre ère ; elle se situe dans la partie orientale du territoire de la cité des Andicaves. Dotée d'une parure monumentale (édifice de spectacle, nymphée...) déjà connue, mais aujourd'hui mieux comprise, elle révèle peu à peu des éléments de son habitat aggloméré, ainsi que ses limites physiques. L'aqueduc, qui suit un parcours de 1,3 km, permet de mieux appréhender le circuit de l'eau dans l'agglomération, l’une des clés majeures de compréhension du site gennois. Puis, avec le haut Moyen Age, l'agglomération se transforme et ses limites évoluent. De nouveaux éléments polarisateurs apparaissent, dont sans doute la nécropole à sarcophages et l'église Saint-Vétérin.