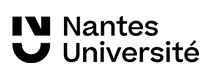Inventaire des ports maritimes et fluvio-maritimes anciens de Bretagne
Inventaire des ports maritimes et fluvio-maritimes anciens de Bretagne

Vue depuis l’ouest du promontoire du Yaudet (Côtes d’Armor), qui domine l’anse de la Vierge et le Léguer (crédits : J. Remy, avril 2024)
Ce programme a été réalisé dans le cadre d’un appel à projet de la région Bretagne. Il est le fruit d’une collaboration interinstitutionnelle mise en place entre le Ministère de la Culture représenté par le DRASSM et par le SRA de Bretagne, Nantes Université et le CNRS. Il s’insère dans un programme de recherche plus vaste, initié en 2019, dont la finalité est de progresser concrètement quant à la connaissance des emplacements portuaires anciens, protohistoriques ou historiques. Il s’appuie sur une longue expérience scientifique en termes d’archéologie navale et portuaire, mais également en matière de valorisation ou de méthodologie – recours à la géomatique ou à la prospection archéologique.
Lieu : Région Bretagne
Nature de l'opération : Inventaire et analyse géoarchéologique
Date : 2021 - 2024
Direction de l’opération : Julie Remy (CNRS, UMR 6566 - CReAAH-LARA), Jimmy Mouchard (Nantes Université, UMR 6566 - CReAAH-LARA), Olivia Hulot (DRASSM/Ministère de la Culture, UMR 6566, CReAAH).
Soutien : CNRS, Nantes Université, SRA/DRAC de Bretagne, DRASSM/ministère de la Culture, Service de l’Inventaire du Patrimoine Culturel, UMR 6566, CReAAH-LARA.
Le programme

Les objectifs
- Recenser les espaces naturels les plus propices à l’implantation portuaire du littoral breton et les confronter à la carte archéologique.
- Décrire et étudier les contextes géographiques (reliefs, géomorphologie du trait de côte, géologie, nature du sous-sols) des zones définies et évaluer leurs potentiels en termes de vestiges archéologiques depuis la Protohistoire jusqu’à l’époque moderne.
- Au sein de ces zones – qui peuvent atteindre plusieurs kilomètres de long –, identifier et cartographier le plus précisément possible les sites susceptibles d’avoir servis d’espace portuaire. En outre, il s’agit de définir les fenêtres d’étude les plus significatives avant d’effectuer une reconnaissance sur le terrain.
- Mettre en valeur ses sites patrimoniaux visibles et invisibles par le biais d’une couverture photographique des éléments conservés dans le paysage (équipements visibles et conservés) et ceux induits par l’analyse archéogéographique (sites portuaires fossilisés, etc.).
Les enjeux
Ce programme présente un double enjeu pour l’archéologie :
- Mieux définir les zonages de protection, afin d’orienter les politiques de prescription archéologique ;
- Cet inventaire constitue une étape décisive dans la mise en place d’un programme de recherche plus vaste, qui vise à progresser quant à la connaissance des emplacements portuaires anciens sur le littoral breton. Il doit aboutir à la sélection d’un ou de plusieurs sites candidats (de « zones atelier »), qui feront l’objet d’opérations de terrain, combinant à une approche géomorphologique, des opérations de reconnaissance (prospection pédestre, subaquatique ou sous-marine), des prospections géophysiques, des campagnes de sondages et de fouilles.

Illustration : Maçonnerie en pierre sèche sur la plage au pied du Petit Resto à Lanester (Morbihan), correspondant à de probables aménagements de berge (cl. J. Mouchard, octobre 2022).