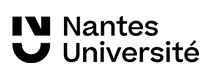L'agglomération secondaire du Langon
Projet collectif de recherche - L'agglomération secondaire du Langon, Vendée

Fouille du site du Chatelier [Hôtel du Laurier Rose, Salle Polyvalente], 1986. Crédits : CD85, Émile Bernard
Lieu : Le Langon, Vendée
Enjeux du programme : Le Projet Collectif de Recherche ambitionne de reprendre l’intégralité de la donnée disponible sur l’agglomération antique du Langon et de la réinterroger au regard des connaissances actuelles
Nature de l’opération : Projet Collectif de Recherche (2024-2026)
Direction administrative : Aurélien Hamel (chercheur associé UMR 6566 CReAAH – LARA)
Direction scientifique : Aurélien Hamel (département de Vendée, UMR 6566 CReAAH-LARA) et Jérôme Pascal (Inrap)
Soutien : Ministère de la Culture – DRAC des Pays de la Loire, Conseil départemental de la Vendée, Conseil départemental de Loire-Atlantique, Inrap, Archeodunum, Universités de Nantes, de Rennes, de La Rochelle, UMR 6566 – CReAAH (LARA et LAHM), UMR 5199 - PACEA, UMR 7324 - CITERES, UMR 8164 - HALMA, UMR 7266 – LIENSs, Alter Ego Rennes Archéologie et la Mairie du Langon
Le projet

Emprises des opérations archéologiques (OA) dans le périmètre supposé de l’agglomération antique du Langon (CAO : PCR Agglomération antique du Langon).
D’après la base de données Patriarche, environ 8 ha ont déjà fait l’objet d’études ou d’interventions archéologiques depuis les années 1960. Il s’agit toutefois essentiellement de prospections, d’observations ponctuelles (sondages) ou de diagnostics, les surfaces réellement fouillées jusqu’au substrat étant beaucoup plus réduites. Les données issues de ces interventions sont relativement abondantes mais éparses. Bien que ces découvertes aient fait l’objet de plusieurs synthèses (Bernard, Couprie 1991 ; Provost et al. 1996, Bernard, Monteil 2007 ; Pascal, Bonin 2019 ; Provost et al. 2024), la genèse et le développement de cette agglomération restent incertaines.
Le PCR ambitionne de reprendre l’intégralité de la donnée disponible et de la réinterroger au regard des connaissances actuelles. La mise à plat de ces informations permettra peut-être de répondre à certaines questions :
- l’existence d’un port fluvio-maritime : celle-ci est avancée de longue date ; la mise au jour en 1968-1969 d’un entrepôt de céramiques importées ainsi que le positionnement de l’agglomération sur la rive nord du « golfe des Pictons », vraisemblablement encore navigable à la période antique, sont considérés comme des indices objectifs mais le site des installations portuaires n’a pas encore été localisé à ce jour ;
- l’organisation de l’agglomération (quartiers d’habitation et/ou artisanaux, réseau de rues) reste très mal connue. Les multiples opérations menées depuis le XIXe s. ont permis d’appréhender de manière précise l’étendue de l’agglomération même si sa structuration reste difficile à définir (les tentatives d’identification d’une trame orthogonale régissant la voirie et le bâti menées par Émile Bernard ne sont pas concluantes).
- les sites de productions : sel, ostréiculture, céramique, etc. De nombreux sites de production de sel (sites de briquetage) sont connus sur la commune. Ils ont fonctionné entre La Tène moyenne et La Tène finale. Durant la période antique, cette activité n’est apparemment plus pratiquée. Pourquoi ? Parallèlement, l’ostréiculture ou plus précisément la récolte raisonnée des huîtres sauvages semble prendre une place importante ; une production de garum est suspectée. La découverte récente de deux fours de potier accrédite l’existence d’une production céramique locale.
- l’agglomération du Langon s’inscrit dans un territoire et dans la Cité des Pictons et plus largement dans le grand ouest (desserte par voie terrestre et fluviale). Les agglomérations secondaires de la moitié est de la cité des Pictons, et plus particulièrement autour de la capitale de cité, Lemonum-Poitiers, sont beaucoup mieux connues que celles de la moitié ouest, qui sont de tailles plus réduites.
- florissante au Haut-Empire, l’agglomération semble péricliter dès le IIe s. ap. J.-C. Néanmoins, l’existence de deux grandes nécropoles chrétiennes alto-médiévales et d’un petit groupe de tombes mérovingiennes au sein même de l’agglomération tendent à nuancer cette idée.
Après une première année probatoire en 2023, le Projet Collectif de Recherche sur l’agglomération antique du Langon est pleinement rentré dans sa phase active en 2024.
Ce PCR réunit une vingtaine de chercheurs qui dépendent d’institutions diverses (Ministère de la culture – DRAC des Pays de la Loire, service d’archéologie de Vendée et de Loire-Atlantique, Inrap, Archeodunum, Université de Nantes, de Rennes, de La Rochelle, UMR 6566 - CReAAH, UMR 5199 - PACEA, UMR 7324 - CITERES, UMR 8164 - HALMA, UMR 7266 - LIENSs). Depuis mai 2024, la mairie du Langon fait également parti du projet en tant que personne morale.