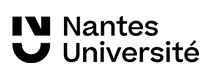Les AGGlomérations Laténiennes du nord-Ouest de la Gaule (AGGLO)
Programme Collectif de Recherche – Bretagne – Pays de la Loire : Les AGGlomérations Laténiennes du nord-Ouest de la Gaule (AGGLO)

Agglomérations laténiennes et localisation de la zone d’étude (crédits : J. Remy, 2022 © CNRS)
Nature de l'opération : PCR avec opérations archéologiques (prospections et fouilles) et géophysiques
Date : 2023-2026
Co-direction : Julie Remy (CNRS, UMR 6566 - CReAAH-LARA) et Elven Le Goff (INRAP, UMR 6566 - CReAAH-LARA)
Soutien : Ministère de la Culture, CNRS, INRAP, Nantes Université, La Rochelle Université, Université de Poitiers, Université Rennes 2, Eveha, Société Jersiaise, Service archéologique de Loire-Atlantique, Musée de Chauvigny, associations CERAM et AuGuRa, Commune de Montrevault-sur-Evre, UMR 6566 CReAAH-LARA, UMR 7266 LIENSs, UR 15071 HeRMA.
Enjeux du programme :
Il a fallu attendre les années 1980 pour constater la publication d’ouvrages qui évoquent délibérément le caractère urbain des oppida, alors reconnus comme les premières villes du nord des Alpes. Vingt ans de plus ont été nécessaires pour que les protohistoriens s’accordent sur l’importance de se démarquer des modèles antiques et médiévaux pour évoquer la question de l’urbanisation à la fin de l’âge du Fer.
Aujourd’hui, on envisage l’idée d’un modèle urbanistique gaulois issu d’un long processus interne au monde celtique, dont il reste à mesurer la diversité des formes et notamment pour les agglomérations non fortifiées, qui émergent au IIIe voire dès la fin du IVe siècle av. n. è. Parce que l’on constate encore la persistance d’un fort déséquilibre dans la répartition spatiale des agglomérations (fortifiées ou non) à l’échelle européenne, avec une frange occidentale qui apparaît en marge de ce phénomène d’urbanisation, le projet AGGLO vise à mieux caractériser l’habitat aggloméré du second âge du Fer des régions Bretagne et des Pays de la Loire. À long terme, il s’agit de mieux appréhender la densité de leurs réseaux et tenter de comprendre les facteurs qui ont conduit à leur émergence.
Ce programme collectif s’appuie sur une analyse critique des données actuelles permettant d’identifier, de caractériser les sites en tant que tel, à partir de leur morphologie, des vestiges et des mobiliers qu’ils ont livrés, des activités et aménagements reconnus et des fonctions ou statuts auxquels ils peuvent éventuellement prétendre. Si pour un certain nombre d’entre eux le statut d’« habitat aggloméré avéré » ne fait aucun doute, la reprise de données anciennes pour certains contextes potentiels ou hypothétiques est nécessaire.

Le programme s’articule autour de deux axes :
- Axe 1 : Les territoires et les réseaux – qui a pour vocation d’appréhender les agglomérations au sein leur territoire et de comprendre le fonctionnement de leur(s) réseau(x) de communication terrestre et fluvial ;
- Axe 2 : La morphologie des agglomérations – qui consiste à identifier les agglomérations laténiennes fortifiées et non fortifiées des régions Bretagne et Pays de la Loire, mais également à caractériser leurs formes et leurs fonctions.
Illustration : Le promontoire de Péaule dans le Morbihan. Image issue d’un relevé Lidar : ombrage multidirectionnel (Prospection dirigée par Y. Dufay-Garel, Eveha, et H. Duval, Société Jersiaise ; Traitements : T. Peres, Imaging 4D)